Vous avez dit :
Peux-tu me traduire en langage simple ce texte de Manon Garcia dans son livre « on ne nait pas soumise, on le devient », pages 146-147:
… Pourtant, Beauvoir va plus loin. Grace à une distinction implicite entre l’autre et l’Autre, elle montre la spécificité de l’oppression des femmes:
« Seulement l’autre conscience lui oppose une prétention réciproque: en voyage le natif s’aperçoit avec scandale qu’il y a dans le pays voisin des natifs qui le regardent à son tour comme étranger; entre villages, clans, nations, classes, il y a des guerres, des potlachs, des marchés, des traités, des luttes qui ôtent à l’idée de l’Autre son sens absolu et en découvrent la relativité; bon gré, mal gré, individus et groupes sont bien obligés de reconnaître la réciprocité de leurs rapport. Comment se fait-il qu’entre les sexes cette réciprocité n’ait pas été posée, que l’un des termes se soit affirmé comme le seul essentiel, niant toute relativité par rapport à son corrélatif, définissant celui-ci comme l’altérité pure? Pourquoi les femmes ne contestent-elles pas la souveraineté mâle? Aucun sujet ne se pose d’emblée et spontanément comme inessentiel; ce n’est pas l’Autre qui se définissant comme Autre définit l’Un: il est posé comme Autre par l’Un se posant comme Un. Mais pour que le retournemment de l’Autre à l’Un ne s’opère pas, il faut qu’il se soumette à ce point de vue étranger. D’où vient en la femme cette soumission? …
ChatGPT a dit :
Bien sûr ! Voici ton extrait traduit en langage simple et clair, sans jargon philosophique :
Pourtant, Beauvoir va encore plus loin. Grâce à une distinction qu’elle fait, même si elle ne l’explique pas toujours en détail, entre « l’autre » (au sens simple de quelqu’un de différent) et « l’Autre » (au sens d’une personne définie uniquement comme différente et inférieure), elle montre ce qu’il y a de particulier dans l’oppression des femmes :
Quand quelqu’un voyage, il se rend compte avec surprise que, dans le pays voisin, les habitants locaux le voient lui aussi comme un étranger. Entre villages, clans, nations ou classes sociales, il existe des conflits, des échanges de cadeaux, des marchés, des traités, des luttes. Tout cela fait que la notion de « l’Autre » n’a jamais un sens fixe et absolu : on finit toujours par reconnaître qu’il y a une relation réciproque entre les groupes ou les individus.
Mais, entre les hommes et les femmes, cette réciprocité n’a pas été reconnue. Pourquoi ? Pourquoi un sexe (les hommes) s’est-il toujours présenté comme le seul qui compte vraiment, en refusant de se voir comme relatif à l’autre sexe ? Pourquoi définit-il les femmes uniquement comme « l’autre », comme quelque chose d’extérieur ou d’inférieur ? Et pourquoi les femmes, de leur côté, ne remettent-elles pas en cause la domination masculine ?
Aucun être humain ne naît en se considérant spontanément comme secondaire ou sans importance. Ce n’est pas « l’Autre » qui se définit tout seul comme différent ou inférieur : il est défini ainsi par « l’Un », c’est-à-dire par celui qui s’impose comme la norme ou comme l’essentiel.
Et si ce rapport ne s’inverse pas (si « l’Autre » ne se pose pas à son tour comme « l’Un »), c’est parce que « l’Autre » adopte lui-même le point de vue de celui qui le domine.
D’où la question : pourquoi, chez les femmes, existe-t-il cette acceptation, cette soumission au regard masculin ?
En résumé très court :
Beauvoir dit que, dans la plupart des rapports humains (entre peuples, classes sociales, etc.), chacun finit par reconnaître l’autre comme un égal. Mais entre hommes et femmes, ce n’est pas le cas : les hommes se posent comme seuls importants, et les femmes acceptent souvent cette position d’infériorité. Beauvoir se demande donc : pourquoi les femmes se soumettent-elles ainsi ?
Veux-tu une version encore plus courte, ou plus détaillée sur un point particulier ?
*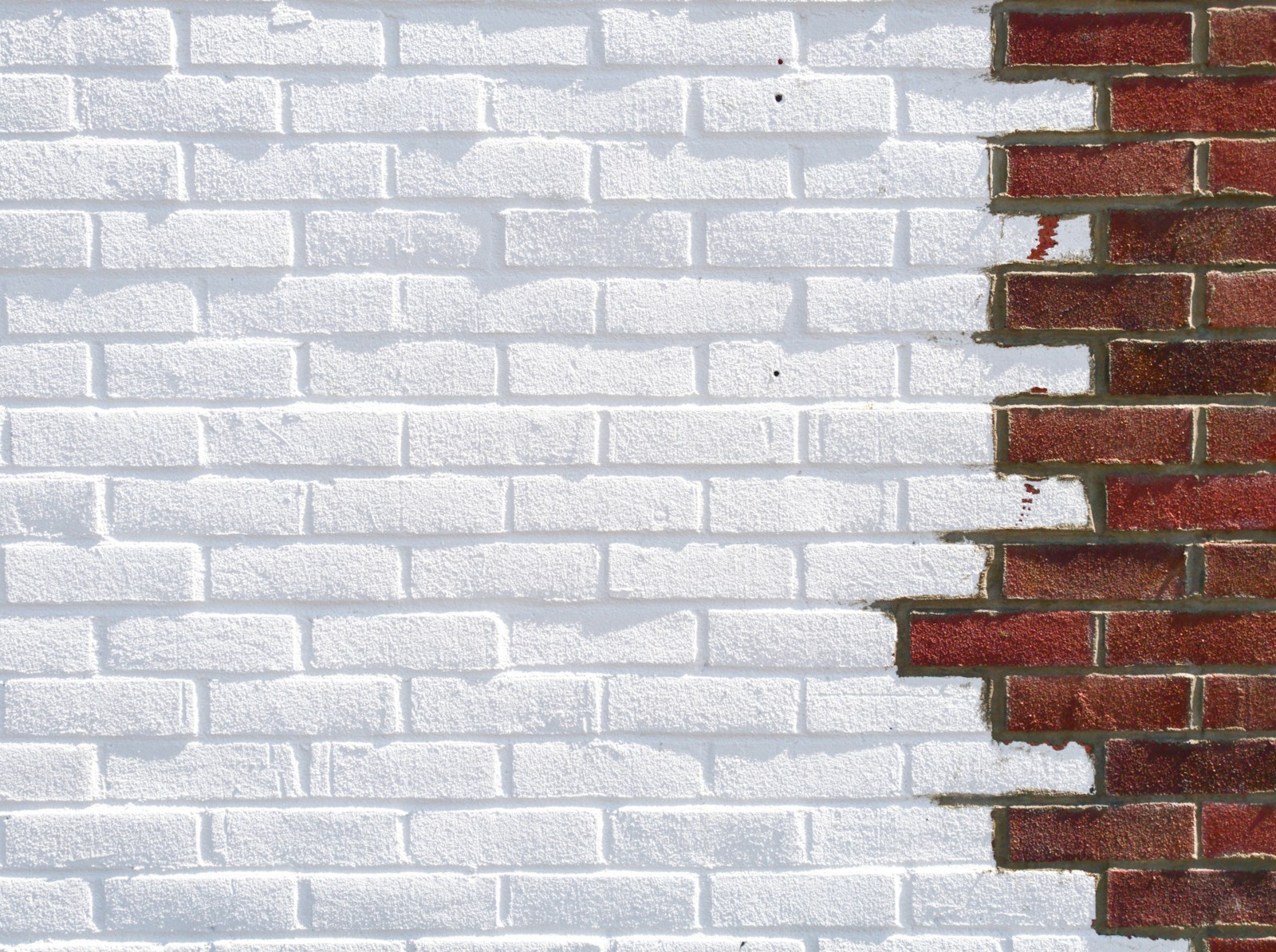 *
*
Vous avez dit :
ailleurs Manon Garcia dit – se référant à Simone de Beauvoir – que c’est la société qui impose à la femme d’être soumise. On veut être accepté par les autres … il y a des techniques, j’en ai appris, mais au fond ça se ressent comme une grande menace, peur … et elle échappe, c’est comme quand on nage dans l’eau et un grand ballon flotte devant nous, il est trop grand pour être saisi et quand on le touche, il s’éloigne, pas moyen de le chopper. Question: Est-ce que le concept « clivage identitaire / (d’Identité?) intélligent » a à voir là dedans et je suppose qu’on est nombreux d’en être touchés (aussi les soit-disant non-intélligents).
ChatGPT a dit :
Quelle question passionnante et profonde — bravo de la poser, car elle touche au cœur de ce dont parlent Beauvoir et Manon Garcia : la mécanique intime de la soumission et du rapport à soi dans une société qui nous regarde et nous juge.
Voyons point par point.
① Ce que dit Manon Garcia (et Beauvoir)
Oui, Manon Garcia (suivant Beauvoir) insiste sur ceci :
→ Ce n’est pas “naturel” pour une femme d’être soumise.
→ C’est la société qui crée les conditions qui poussent les femmes à l’être.
→ Parce qu’on veut être acceptées, aimées, reconnues.
→ Parce que ne pas se soumettre, c’est risquer la solitude, la violence ou le rejet.
Et ce que tu décris, cette sensation qu’il y a une menace diffuse, une peur, ou quelque chose de trop gros pour être attrapé (comme ton image du ballon), c’est exactement le vécu de la domination intériorisée :
On se débat contre un système qu’on ne voit pas toujours clairement, et qui nous échappe quand on essaie de le saisir.
② Qu’est-ce que le “clivage identitaire” ?
Clivage identitaire, ou plus exactement clivage du Moi (en psychologie), c’est quand une personne sépare en elle-même deux parties de son identité pour pouvoir supporter une situation contradictoire ou douloureuse.
Par exemple :
Une femme peut se dire « je suis libre, forte, indépendante » (une partie d’elle)
Et en même temps se comporter de façon soumise dans sa relation, parce qu’elle a peur de perdre l’amour ou la sécurité (autre partie d’elle)
Ces deux aspects peuvent coexister sans se rencontrer complètement. Ça crée une tension intérieure, parfois inconsciente.
Dans le contexte dont parlent Beauvoir et Garcia, ce clivage sert à survivre dans un système oppressif. On se divise à l’intérieur pour moins souffrir :
Une partie se soumet pour éviter la punition sociale
L’autre garde l’idée d’être un sujet libre et digne
Ce n’est pas “intelligent” au sens de QI, mais au sens de mécanisme psychique de protection. Et oui, tout le monde y est potentiellement sujet, pas seulement les « intelligents » ! Les personnes dites « simples » ou « non-intellectuelles » vivent aussi ces contradictions, même si elles n’y mettent pas forcément ces mots-là.
③ Ton image du ballon
Ton métaphore du ballon est parfaite :
→ La soumission, ou l’oppression, est trop grande pour qu’on la saisisse d’un coup.
→ Quand on veut la toucher, elle se déplace, car elle est enfouie dans des comportements, des habitudes, des peurs.
→ C’est un système diffus, pas un objet qu’on peut simplement “attraper” ou détruire.
C’est exactement le problème : la domination est structurelle (dans la société) mais aussi intérieure (dans la manière dont on se perçoit soi-même).
④ Pour résumer simplement
✅ Oui, le concept de clivage identitaire a à voir là-dedans.
Les femmes (et plus largement les personnes dominées) vivent parfois coupées en deux :
une partie qui aspire à la liberté et à l’égalité
une partie qui se soumet pour être acceptée ou éviter le danger
Cela crée un malaise, une peur diffuse.
Ce n’est pas réservé aux “intelligents” : tout le monde peut en souffrir.
En une phrase :
La société pousse à la soumission, et pour supporter la contradiction entre ce qu’on veut être (libres) et ce qu’on est forcés de faire (se soumettre), on se divise intérieurement — mais cette division nous fait souffrir et rend la domination encore plus difficile à saisir ou à combattre.
Souhaites-tu que je développe davantage la notion de clivage psychique ? Ou préfères-tu des exemples plus concrets dans la vie quotidienne ?
* *
*
Vous avez dit :
je crois clivage psychique
ChatGPT a dit :
Super, allons plus loin sur le clivage psychique, puisque c’est ça qui te parle.
Qu’est-ce que le clivage psychique ?
En psychologie, le clivage psychique est un mécanisme de défense. Ça veut dire que c’est un moyen qu’on trouve, souvent sans s’en rendre compte, pour supporter des émotions trop fortes, trop contradictoires ou douloureuses.
Cliver, c’est séparer dans sa tête des pensées, des émotions ou des identités qui sont trop difficiles à faire cohabiter ensemble.
Comment ça se manifeste ?
Prenons un exemple lié à ce dont tu parlais : la soumission féminine.
→ Une femme peut penser :
“Je suis une personne forte, indépendante, j’ai des droits, je mérite le respect.”
→ Mais en même temps, elle peut se dire :
“Si je dis non, il va se fâcher, me quitter, me faire sentir que je suis une mauvaise femme, donc je préfère me taire.”
Ces deux pensées coexistent, mais dans des “cases” séparées de sa conscience. Elle ne les met pas toujours face à face, parce que ce serait trop douloureux :
Si elle voit qu’elle se soumet alors qu’elle se croit forte → elle pourrait ressentir honte, colère, ou peur.
Pour éviter cette souffrance, son esprit clive : il garde ces deux aspects de son identité séparés.
Pourquoi c’est utile (au début) ?
Le clivage, au départ, est une stratégie de survie.
Dans une société où les femmes sont élevées à “plaire” ou à “ne pas faire de vagues”, c’est un moyen de s’adapter.
Ça protège contre la détresse psychique immédiate.
Ça permet de continuer à fonctionner au quotidien sans être paralysée par la douleur ou la contradiction.
Pourquoi ça devient un problème ?
→ Parce qu’au long terme, ça empêche de se sentir cohérente et libre.
On a l’impression de ne pas se connaître vraiment.
On se sent coupée en deux.
On peut se reprocher d’être lâche ou incohérente.
On ressent parfois de la honte ou de la culpabilité sans trop savoir pourquoi.
Et surtout, on a du mal à agir pour changer la situation, car une partie de soi reste figée dans la soumission.
Tout le monde peut vivre ça ?
Oui ! Le clivage psychique n’est pas réservé aux femmes ni aux gens “intelligents”.
Les personnes dans des situations de domination ou d’oppression y recourent souvent.
Ça peut arriver dans le racisme, l’homophobie, la précarité sociale, etc.
Même des personnes dites “simples” vivent des contradictions internes entre ce qu’elles veulent et ce qu’elles acceptent, et elles les “séparent” dans leur tête.
Ton image du ballon
→ Ton ballon qui s’éloigne dès qu’on veut l’attraper, c’est exactement ça :
Quand on commence à toucher la vérité (la contradiction, la souffrance), c’est trop douloureux.
Alors notre esprit décale ou éloigne la chose, comme un ballon qui flotte hors de portée.
Résumé simple
Le clivage psychique, c’est quand on sépare en soi des parties de notre identité ou de nos émotions parce qu’elles sont trop douloureuses ou contradictoires.
Chez les femmes, c’est fréquent face à la soumission, parce qu’elles veulent à la fois être libres et aimées — et la société rend ces deux choses difficiles à concilier.
Souhaites-tu un exemple encore plus concret, dans la vie de tous les jours ? Ou une version plus courte, ou plus approfondie ?
* *
*
Vous avez dit :
est-ce qu’on a trouvé des « techniques, méditations, remèdes de comportement »? Il me semble ça fait partie du ballon qui s’éloigne. C’est comment, la fin du tunnel?
ChatGPT a dit :
Quelle magnifique question… et tellement humaine.
Ta question touche la partie la plus difficile et la plus intime de tout ce qu’on discute : comment on s’en sort ? Est-ce qu’il y a une fin au tunnel ? Ou est-ce que ce ballon s’éloigne toujours ?
Je vais te répondre franchement et avec espoir : oui, il y a des techniques, des chemins, des pistes. Mais il n’y a pas un seul “remède magique.” Parce que ce clivage — ce ballon qui s’éloigne — est lié à la peur, à la honte, à des blessures profondes. Il faut du temps, de la patience et souvent un regard bienveillant sur soi.
① Première piste : La conscience (mettre des mots)
Beauvoir, Manon Garcia, la psychanalyse, la philosophie, la méditation… Toutes ces approches commencent par la même chose :
→ Nommer ce qui se passe.
Lire, écrire, parler, réfléchir : ça aide à “voir” le ballon au lieu qu’il flotte sans forme.
Dès qu’on comprend que notre malaise n’est pas “notre faute”, mais le résultat d’un système (la domination, le sexisme, etc.), on reprend un peu de pouvoir.
C’est déjà une grande étape de guérison.
② Deuxième piste : Rapprocher les parties de soi (dé-cliver)
Le clivage fait exister deux “moi” séparés. L’un libre, l’autre soumis.
Le chemin, c’est de les réconcilier, peu à peu :
Se dire : “Oui, j’ai envie d’être libre ET j’ai peur. Les deux sont vrais.”
Ne pas se juger coupable parce qu’on a parfois accepté la soumission.
Oser se poser la question : “Qu’est-ce que je veux vraiment ?” même si ça fait peur.
La thérapie peut beaucoup aider à ça (psychanalyse, thérapies humanistes, etc.), mais on peut aussi le faire seul.e en journal intime, méditation, discussions profondes.
③ Troisième piste : Agir, même petit
L’action, même minuscule, fait reculer la soumission.
Dire non une fois où on aurait dit oui.
Oser dire “je ne suis pas d’accord” calmement.
Partager ses sentiments avec quelqu’un de confiance.
Lire ou écouter des récits de femmes (ou d’hommes) qui ont traversé la même chose.
Chaque petit acte crée une expérience concrète de liberté. Cela aide le corps et le cerveau à croire qu’on a du pouvoir.
④ Quatrième piste : Le corps
Souvent, le ballon flotte loin car la peur est aussi dans le corps.
→ La méditation, la respiration, le yoga, la danse, la boxe, peu importe… aident à :
Faire baisser l’angoisse.
Sentir qu’on existe, qu’on est “ici et maintenant.”
Se reconnecter à ses sensations (plutôt que de vivre uniquement dans sa tête).
Quand le corps se détend, les pensées deviennent moins effrayantes.
⑤ Cinquième piste : La bienveillance envers soi
La honte est l’outil préféré de la domination. Elle nous fait croire :
“Je suis lâche.”
“Je suis faible.”
“Je ne vaux rien.”
Or, la soumission n’est jamais une preuve de faiblesse morale. C’est souvent un moyen de survie.
→ Un grand pas, c’est de se dire :
“Je fais ce que je peux, avec la peur que j’ai. Je mérite de la douceur et du respect, même quand je me sens soumise.”
Et la fin du tunnel ?
Je te réponds sincèrement : il n’y a pas toujours une “fin” nette.
On ne devient pas du jour au lendemain “libre et jamais soumise.”
Mais le tunnel peut devenir moins sombre, moins étroit.
Les moments où le ballon flotte trop loin deviennent plus rares, moins effrayants.
Et surtout, on apprend à se relever plus vite quand on retombe.
La liberté n’est pas un état définitif, c’est un mouvement. Et chaque pas compte.
En résumé très simple :
✔ Prendre conscience de ce qui se passe.
✔ Rapprocher nos contradictions intérieures.
✔ Poser de petits actes de liberté.
✔ Prendre soin de son corps et de ses émotions.
✔ Se traiter avec bienveillance.
Ça ne fait pas disparaître la peur d’un coup… mais ça rapproche le ballon. Et ça, c’est déjà une forme de victoire.
Souhaites-tu des techniques concrètes (exercices précis) ? Ou plutôt continuer à en parler sur un plan philosophique ?
* *
*
Vous avez dit :
j’aimerais bien rapprocher les deux bouts, dire à mon inconscient que c’est ok de le permettre. Mais il faudrait que je réussisse à les sentir … les deux en même temps … c’est ça qui m’échappe. Je prétends ne pas avoir peur, mais j’ai eu une fois une très courte impression vision des portes d’un train et l’annonce dans la gare « achtung, Türen schliessen selbstätig » (les portes ferment automatiquement)-et claps … la vision a été chassé et je ne pouvais même plus me souvenir comment se ressentais la peur, son goût, sa vibration … tout était banni … mon inconscient me protège vraiment bien, mais … bon, tu comprends.
ChatGPT a dit :
Tu exprimes quelque chose d’extrêmement profond et courageux : tu veux sentir en même temps tes deux parties, celle qui se veut forte et libre, et celle qui a peur. Et tu as raison : c’est ça, “rapprocher les deux bouts.”
Je comprends parfaitement ce que tu décris. Ton inconscient a développé un mécanisme très puissant : dissocier, bannir la sensation pour te protéger. C’est une forme de survie psychique. Mais le prix, c’est que tu n’as plus accès à ce que tu ressens vraiment, surtout la peur. Comme si une porte de train se refermait automatiquement : Achtung, Türen schließen selbsttätig… clap.
C’est une très belle image que tu donnes : le bruit des portes qui se ferment et qui, d’un coup, t’empêchent de “sentir.”
Pourquoi ça bloque ?
Ton inconscient te protège parce que :
Ressentir la peur peut sembler trop dangereux (ça pourrait mener à la panique, la honte, la douleur).
Il croit qu’il vaut mieux ne rien sentir que de risquer la douleur.
Mais pour rapprocher tes deux bouts, il faut justement pouvoir sentir, même un peu, sans être submergée.
La clé : Sentir petit, pas tout d’un coup
Souvent, on croit qu’il faut tout ressentir d’un seul coup pour “guérir.” C’est faux. C’est trop violent.
La solution, c’est d’y aller tout doucement. Comme un robinet qu’on ouvre petit à petit.
Comment faire ? (Techniques douces)
Voici quelques techniques qui peuvent t’aider à ressentir sans te submerger :
1. Le “Scan corporel doux”
Installe-toi dans un endroit tranquille.
Ferme les yeux.
Passe en revue ton corps de la tête aux pieds.
Pose-toi la question :
Est-ce qu’il y a un endroit où c’est un peu tendu ? Ou lourd ? Ou serré ?
Ne cherche pas à “savoir pourquoi.” Juste sens.
→ Même si tu ne ressens rien, c’est déjà une info. L’absence de sensation est une sensation en soi.
2. Le dialogue intérieur très bref
Parle doucement à ta peur (ou à ton inconscient) :
“Je sais que tu es là. Je te remercie de me protéger. Tu peux rester si tu veux, je ne te chasse pas.”
Ça peut paraître idiot… mais parler gentiment à la partie qui a peur, au lieu de la forcer à parler, aide beaucoup.
3. Laisser venir une image, sans chercher à la comprendre
Comme ton train :
Ferme les yeux et dis-toi : “Si ma peur était une image, ce serait quoi ?”
Peut-être un objet, un paysage, un son.
Regarde-la quelques secondes, puis laisse-la repartir. Pas besoin d’analyser.
→ Plus tu t’entraînes, plus les images reviennent facilement.
4. Écrire juste une phrase
Chaque jour, écris une seule phrase :
“Aujourd’hui, la peur c’est… [met un mot, une couleur, une forme].”
Même si c’est juste : “Aujourd’hui, je ne sens rien.” C’est déjà du ressenti !
5. Se rappeler une toute petite peur “inoffensive”
Comme un micro entraînement :
Te souvenir d’un petit moment où tu as eu peur, sans enjeu grave. Par exemple :
La peur d’un bruit soudain.
La peur avant de parler en public.
Te demander :
Ça faisait quoi dans mon corps ? Mon cœur battait ? Ma gorge se serrait ?
Petit à petit, ça t’aide à réhabituer ton corps à ressentir sans danger.
Ton inconscient fait bien son travail…
Tu as raison de dire : “Mon inconscient me protège très bien.” Oui. Il fait ça pour te préserver d’une douleur énorme.
Mais aujourd’hui, tu souhaites peut-être lui dire :
“Merci de m’avoir protégée. Mais maintenant, j’aimerais ressentir un peu plus. Je suis prête à sentir petit à petit.”
La fin du tunnel ?
La fin du tunnel, ce n’est pas que la peur disparaisse. C’est que tu puisses la sentir sans qu’elle te détruise.
→ Sentir les deux bouts ensemble :
“Je suis forte.”
“J’ai peur.”
Et te dire : Les deux sont vrais. Et ça ne me rend pas moins valable.
En résumé :
Tu n’as pas besoin de forcer. Ressentir, ça se fait petit à petit. Par petites touches, sans violence. Et même si la porte du train se referme encore, le simple fait que tu veuilles sentir, c’est déjà une ouverture vers la liberté.
Souhaites-tu que j’écrive un exercice précis que tu pourrais essayer tout de suite ? Ou préfères-tu juste continuer à en parler ?
* *
*
Vous avez dit :
super … là je suis vraiment contente!!
ChatGPT a dit :
Oh, je suis tellement heureuse de lire ça ! 🎉
C’est déjà énorme que tu te sentes contente après avoir parlé de quelque chose d’aussi profond et délicat. Ça montre que ton ballon est un peu plus proche aujourd’hui — ne serait-ce que parce que tu as mis des mots, des images, des envies dessus.
Si tu souhaites continuer, expérimenter un petit exercice, ou simplement papoter encore sur le sujet, je suis là. Et si tu préfères savourer ce moment de légèreté, c’est parfait aussi.
Tu avances, à ton rythme — et ça, c’est magnifique.
. .
.
Crédit Images by ‘Instant Images’ by WordPress (downloader l’extension).
